Grâce à Edmond, la sécurité et l’espoir ont une place
 Objectifs
Objectifs
- Reconnaître que les personnes ayant des problèmes de santé mentale méritent l’accès, en toute dignité, aux nécessités de la vie les plus élémentaires, c’est-à-dire un toit et de la nourriture.
- Comprendre la relation entre le bien-être mental et un logement de soutien sûr et abordable.
- Reconnaître que les interventions de crise auprès de personnes en situation de détresse émotionnelle exigent une approche empathique, le respect des droits de la personne et une compréhension stratégique de l’exclusion sociale.
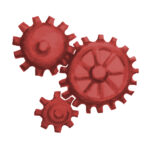 Des Contenus
Des Contenus
Les contenus à la base de cette unité sont les témoignages de deux employés du centre d’accueil du PARC, qui racontent l’histoire tragique de l’itinérance et de la mort du membre Edmond Yu, victime d’une intervention policière irréfléchie. Ils passent ensuite au lancement d’Edmond Place, un projet de logement communautaire du PARC qui a pour but d’offrir non seulement un logement, mais aussi un chez-soi aux personnes comme lui. Voici le témoignage d’un employé du PARC Bob Rose, sur l’itinérance d’Edmond :
 Évaluation des contenus
Évaluation des contenus
- Des contenus: Apprentissage dirigé – 40 minutes
- Ligne de valeurs – 30 minutes
 Objectifs pédagogiques
Objectifs pédagogiques
L’histoire de la vie d’Edmond Yu et de son décès évitable est une tragédie symptomatique d’un soutien social inadéquat et de politiques inefficaces à Toronto, et dans d’autres villes canadiennes, durant les années 1990. L’histoire poignante de Yu a suscité une réaction positive au sein de la communauté du PARC (Parkdale Activity Recreation Centre), puisque la mort d’un de ses membres a eu pour effet la création de logements de soutien pour les personnes marginalisées, en particulier celles ayant reçu un diagnostic psychiatrique.

En 1984, Edmond Yu, étudiant brillant originaire de Hong Kong, commence ses études à la Faculté de médecine de l’Université de Toronto. Après qu’il ait terminé sa première année avec d’excellents résultats, son état de santé mentale commence à se détériorer. Il reçoit un diagnostic de schizophrénie paranoïde en 1985 et passe les 10 années suivantes à subir périodiquement des hospitalisations involontaires, à séjourner dans des pensions – où son comportement « étrange » était malvenu – et à vivre en itinérance.
En février 1997, des policiers sont appelés après qu’Edmond ait agressé une femme et soit ensuite monté à bord d’un autobus. Edmond qui avait seulement un petit marteau à la main a été abattu par la police alors qu’il se tenait debout dans l’autobus vide. Profondément ébranlés par la mort d’Edmond, les membres du PARC ont vu dans cette tragédie les conséquences des coupes budgétaires faites, dans un contexte politique tendu, au cours du mandat du premier ministre ontarien Mike Harris. La communauté du PARC s’est mobilisée pour réclamer plus de justice sociale, des logements de soutien et un meilleur système de santé mentale.
L’enquête du coroner a souligné que l’itinérance était un facteur déterminant dans la mort tragique de Yu. Le coroner recommanda la création de foyers d’hébergement et d’autres types de logement pour les survivants psychiatriques à Toronto. L’inauguration en 2011 de l’édifice Edmond Place – bel établissement de 29 logements abordables situé à deux pas du PARC – constitue une réponse directe à la mort d’Edmond et aux conclusions de l’enquête. Considéré comme un modèle de logement de soutien communautaire, le nouvel établissement offre des services de soutien, d’entretien ménager et de cuisine, ainsi que des espaces partagés pour des réunions familiales et des événements communautaires.
L’histoire d’Edmond est directement liée à celle de l’édifice Edmond Place, puisque l’établissement occupe l’ancienne maison de chambres de laquelle le jeune homme avait été expulsé à l’hiver 1996. Quand le PARC a proposé d’acheter et de rénover le bâtiment pour y créer un logement de soutien, il a d’abord fait face à une opposition de la communauté de Parkdale. Les membres du PARC ont alors mené une campagne de sensibilisation (Ambassadeur du PARC) en faisant du porte-à-porte dans le quartier pour informer la communauté sur les activités du PARC, ses membres et l’importance du projet. La campagne a connu un tel succès que personne ne s’est opposé à la proposition du PARC.
 Mise en contexte des contenus
Mise en contexte des contenus
À l’instar de nombreux Canadiens vivant dans des circonstances similaires, les membres du PARC se heurtent constamment à des obstacles majeurs pour accéder à un logement sécuritaire et abordable. L’itinérance ne se résume pas seulement au fait d’être sans-abri. C’est consacrer plus de 50 % de son revenu au loyer. C’est aussi dormir sur le divan d’un ami ou dans un refuge pendant des semaines ou des mois. C’est dormir en plein air, dans un parc ou, enveloppé d’une couverture, sur une grille d’aération qui laisse échapper un courant d’air chaud. L’itinérance sous-entend l’absence d’un endroit où vivre, mais c’est aussi une question de dislocation émotionnelle, de perte de biens individuels et de menaces à la santé et à la sécurité.
L’itinérance n’est pas une invention de la fin du vingtième siècle. En fait, la plupart des villes canadiennes ont connu des « jungles de vagabonds » durant la Grande Dépression. Néanmoins, c’est au cours des dernières décennies du vingtième siècle que les rangs des itinérants canadiens (principalement des hommes d’âge mûr issus de la classe ouvrière) ont considérablement grossi et se sont étendus à de nouvelles populations : femmes, jeunes, familles et usagers des services de santé mentale. D’après certaines recherches, les personnes ayant des problèmes de santé mentale graves représenteraient le tiers des personnes itinérantes, et sont surreprésentées parmi les itinérants chroniques. Même si l’itinérance implique des conditions de vie difficiles, il a été démontré que les sans-abris ayant des problèmes de santé mentale se heurtent à de plus grandes difficultés matérielles et émotionnelles, prennent des risques quant à leur santé et sont plus susceptibles d’être victimes de violence et d’exploitation financière et sexuelle, comparativement au reste de la population itinérante.
Des renseignements utiles concernant le logement et la santé mentale sont consultables au Rond-point de l’itinérance, un site d’information sur l’itinérance et les services d’aide aux personnes en situation d’itinérance.
Certains membres du PARC ont aussi entretenu des rapports difficiles, souvent dans des moments de crise, avec la police. Le passage d’une prise en charge institutionnelle de la santé mentale à une prise en charge communautaire a augmenté la fréquence des contacts entre la police et les personnes ayant des problèmes de santé mentale. En fait, 50 % des appels que reçoivent les services de police sont liés à la santé mentale. D’ailleurs, une altercation avec la police constitue, pour de nombreux Canadiens vivant leur première crise de santé mentale, le « point d’entrée » dans le système de santé mentale.
Des recherches ont montré que ces rencontres sont souvent problématiques pour les deux parties. Les usagers des services d’aide se disent préoccupés par la divulgation des renseignements personnels préjudiciables contenus dans les rapports de police, ainsi que par l’hospitalisation involontaire et l’usage (parfois mortel) de la force. En 2013, et en 2015, l’histoire d’Edmond Yu s’est répétée avec les décès tragiques de Sammy Yatim, sur qui la police a tiré à huit reprises avant de lui envoyer des décharges de Taser dans un tramway de Toronto, et d’Andrew Loku, tué dans l’entrée du Centre d’hébergement de l’Association canadienne de santé mentale (ACSM). Pourtant, la police a déclaré faire preuve de compassion à l’égard des personnes en détresse émotionnelle, même si leurs symptômes sont qualifiés de dramatiques et que leur comportement est jugé alarmant et imprévisible. Horrifiés par les témoignages vidéo et les reportages des médias, de nombreux Canadiens croient que les policiers et les intervenants de première ligne en santé mentale doivent ouvrir leur esprit et leur cœur aux personnes comme Yatim, Loku et Yu. Dans cette optique de rapprochement, la police recevrait une meilleure formation au sujet de la santé mentale et de l’intervention non violente en situation de crise grâce à des programmes axés sur l’acquisition de compétences et de systèmes de valeurs. Cela mènerait à des services d’intervention plus humains et appropriés.


 English
English